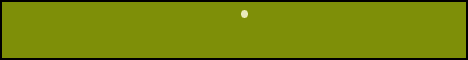Elle se divise donc en deux parties : en tant que science, elle est ce que l'on appelle logique pure ou logique formelle ; en tant qu'art de penser, elle est la logique appliquée ou méthodologie. ( Les scolastique exprimaient cette différence en distinguant une logica docens et une logica utens ).
SECTION1
CHAPITRE PREMIER
Des degrés d'assentiment. Certitude et probabilité.
286. Degrés d'assentiment.
Avant d'étudier les lois que suit l'entendement dans l'acquisition de la vérité, il est bon de faire connaître les différents états où l'esprit peut se trouver par rapport au vrai et au faux : par exemple, s'il possède le vrai, c'est la science ; s'il en est privé, c'est l'ignorance ; s'il hésite, c'est le doute, etc. C'est ce que Bossuet ( I,XIV ) appelle les dispositions de l'entendement, et Leibniz avec Locke ( Essai, IV, XVI ), les degrés d'assentiment. Kant a également consacré un chapitre à ce sujet dans sa Critique de la raison pure ( Méthodologie transcendantale, ch.II, sect. III ).
La science.- Bossuet définit la science par les caractères suivants :
( Quand par le raisonnement on entend certainement quelque chose, qu'on en comprend les raisons, et qu'on a acquis la faculté de s'en ressouvenir, c'est ce qui s'appelle science. Le contraire s'appelle ignorance.
La certitude.- Le caractère propre de la science est la certitude. Qu'est-ce que la certitude ? C'est l'état de l'esprit qui adhère à la vérité sans aucun mélange de doute. Pour l'entendre il faut définir le doute.
Le doute.- Le doute est la suspension du jugement. Lorsque les raisons qui militent en faveur d'une opinion sont ou nous paraissent équivalentes à celles de l'opinion contraire, nous ne pouvons pas nous prononcer entre elles ; nous ne donnons notre assentiment ni à l'une ni à l'autre : nous restons suspendus entre les deux ( dubitatio ) : nous doutons.
Ainsi la science, considérée au point de vue subjectif, c'est-à-dire au point de vue du sujet pensant, se caractérise par la certitude et s'oppose au doute : mais au point de vue objectif, elle se caractérise par la possession de la vérité et elle s'oppose soit à l'ignorance, soit à l'erreur.
287. Le vrai et le faux.
Qu'est-ce que la vérité ?
Le vrai, dit Bossuet, est ce qui est ; le faux est ce qui n'est pas.
On peut, en effet, entendre la vérité, soit comme un attribut de la pensée, soit comme un attribut des choses. Dans le premier sens, le vrai est la conformité de la pensée à son objet, c'est-à-dire à ce qui est. Dans le second cas, c'est l'être lui-même, et, comme dit Bossuet, c'est ce qui est « On a objecté ( Hartzen, Principes de logique, note 1 ) que si le vrai est ce qui est, un mensonge doit être vrai. Cette objection est un sophisme : car le mensonge consiste à dire ce qui n'est pas. ». Ainsi on dira, dans le premier sens, que j'ai une pensée vraie, quand je prédis une éclipse et que cette éclipse a lieu en effet : car ma pensée était conforme à l'objet. Dans l'autre sens, toutes les lois de la nature, les propriétés géométriques, l'ordre moral, l'essence de Dieu, en un mot, l'ensemble des choses compose la vérité ; et comme Dieu est le principe de cet ordre, c'est lui qui est la vérité même : Ego sum veritas.
De même, le faux peut-être considéré soit dans la pensée, soit dans les choses. Dans la pensée, c'est la non-conformité de la pensée à son objet. Dans les choses, c'est ce qui n'est pas.
288. L'erreur et l'ignorance
Il importe maintenant de distinguer l'erreur et l'ignorance :
Errer, c'est croire ce qui n'est pas ; ignorer, c'est simplement ne savoir pas.
Socrate disait avec raison que l'erreur est une double ignorance : car celui qui se trompe ignore la vérité, cela est évident ; mais de plus il ignore qu'il ignore : c'est donc ignorance sur ignorance.
On a pu remarquer que dans sa définition de la science Bossuet introduit la mémoire ; c'est, dit-il : « la faculté de se ressouvenir » de ce qu'on a une fois compris. Locke est du même avis ( IV, XVI, ch. 1 ) La science implique donc l'assentiment non seulement de ce que l'on comprend actuellement, mais encore à ce que l'on se souvient d'avoir compris : car aucun géomètre ne peut avoir à la fois toute la géométrie présente à l'esprit : et c'est par là aussi, comme l'a remarqué Descartes, qu'il peut y avoir une part de doute, même dans la science : « Car je me souviens d'avoir souvent estimé beaucoup de choses pour vraies et certaines, lesquelles, par après, d'autres raisons m'ont porté à juger absolument fausses. » 1ère Méditation.
289. L'opinion et la foi.
Indépendamment de la science, il y a encore deux états de l'esprit par rapport à la vérité : l'opinion et la foi. L'opinion consiste à juger « sur des raisons probables et non tout à fait convaincantes ».
C'est l'opinion, qui « encore qu'elle penche d'un certain côté, ainsi qu'il a été dit, n'ose pas s'y appuyer tout à fait, et n'est jamais sans quelques crainte ».
Dans la pratique, l'opinion arrive souvent à une confiance presque aussi grande que celle que donnerait la science, car, dit Locke :
« Il n'y a peut-être personne au monde qui est le loisir, la patience et les moyens d'assembler toutes les preuves de part et d'autre… cependant le soin de notre vie et de nos plus grands intérêts ne saurait souffrir de délais, et il est absolument nécessaire que notre jugement se détermine. » ( IV, XVI, ch. 3 )
Mais cette certitude toute pratique de l'opinion n'est pas comparable à la certitude absolue de la démonstration scientifique.
La foi. C'est un état d'esprit qui consiste à croire, dit Bossuet, sur le témoignage d'autrui, et alors, ajoute-t-il :
Ou c'est Dieu qu'on croit, et c'est la foi divine, ou c'est l'homme, et c'est la foi humaine.
La foi divine n'est sujette à aucune erreur, parce qu'elle s'appuie sur le témoignage de Dieu, qui ne peut tromper, ni être trompé. La foi humaine, en certains cas, peut-être aussi indubitable, quand ce que les hommes rapportent passe pour constant dans tout le genre humain, sans que personne le contredise, par exemple, qu'il y a une ville nommée Alep et un fleuve nommé Euphrate, et quand nous sommes très assurés que ceux qui nous rapportent quelque chose n'ont aucune raison de nous tromper.
290. Les degrés d'assentiment d'après Kant.
Kant, dans la Raison pure, reprend les mêmes distinctions en les caractérisant d'une manière plus systématique. Il distingue aussi trois états : l'opinion, la croyance et la science.
Tout assentiment de l'esprit repose sur des principes qui peuvent être subjectivement ou objectivement suffisants. Ils le sont subjectivement quand ils suffisent pour nous persuader ; ils le sont objectivement quand ils sont de nature à s'imposer également à tout esprit jugeant des mêmes choses. Cela posé,
L'opinion, selon Kant, est une affirmation qui a conscience d'être insuffisante, tant subjectivement qu'objectivement. Si elle n'est suffisante que subjectivement et qu'elle soit en même temps regardée comme objectivement insuffisante, elle s'appelle croyance. Enfin, si cette affirmation vaut à la fois objectivement et subjectivement, elle s'appelle science.
Comment distinguer ces trois états l'un de l'autre ? car souvent l'opinion paraît se confondre avec la croyance, et la croyance, au moins subjectivement, a toutes les apparences du savoir.
Pour ce qui est des deux premiers états, à savoir : simple opinion, ou conviction avec croyance, Kant propose une pierre de touche ingénieusement choisie, à savoir, le pari :
Souvent il arrive, dit-il, que quelqu'un affirme d'un ton si confiant et si imperturbable, qu'il semble avoir déposé toute crainte d'erreur. Mais un pari l'embarrasse. Quelquefois cependant il estime sa persuasion jusqu'à un ducat et non pas à dix. Car il en mettra bien un en jeu ; mais s'il s'agit d'en mettre dix, il remarquera à la fin ce qu'il n'avait pas remarqué d'abord, c'est qu'il est cependant possible qu'il ait tort.
Voilà l'opinion distinguée de la croyance ; mais comment distinguer la croyance, ou persuasion subjective, de la science qui est en même temps objective ? Kant propose un nouveau criterium : c'est la vérification sur autrui.
L'épreuve que l'on fait, dit-il, sur l'entendement d'autrui des principes qui sont valables pour nous, afin de voir s'ils produisent sur une raison étrangère la même effet que sur la nôtre, est un moyen qui, bien que purement subjectif lui-même, nous sert cependant à découvrir la valeur toute personnelle de notre jugement.
Dans beaucoup d'autres cas, une autre pierre de touche est la vérification expérimentale. Ainsi, par exemple, l'opinion de ceux qui croyaient que la terre était ronde est devenue science lorsqu'on a pu faire le tour de la terre.
Quant à une difficulté plus profonde qui pourrait s'élever, et qui consisterait à soutenir que tout le savoir humain, dans son ensemble, repose en définitive sur une croyance invérifiable à savoir, la croyance à la légitimité de nos facultés, cette difficulté doit être renvoyée à la discussion du scepticisme.
De toutes les distinctions précédentes, celle qui importe le plus à la logique, et qui, dans l'intérêt de nos recherche ultérieures, doit être la plus approfondie quant à présent, est celle de la certitude et de la probabilité.
291. De la certitude.
La question de la certitude peut-être discutée à deux points de vue ontologique et objectif, et en ce sens elle appartient à la métaphysique ; ou bien au point de vue formel et subjectif, et elle appartient alors à la logique.
Le premier point de vue consiste à se demander qu'elle est l'autorité, la légitimité, la portée de la raison humaine considérée dans son ensemble et dans ses principes, quel est le dernier fondement de nos connaissances. Cette question, comme tout ce qui concerne les premiers principes, est du ressort de la métaphysique. Le scepticisme est une théorie métaphysique, et ne peut-être discuté que par la métaphysique.
Mais le scepticisme lui-même admet qu'au point de vue formel, c'est-à-dire au point de vue des lois de notre esprit, sinon de l'ordre réel des choses, il y a une différence entre le douteux, le probable et le certain. Aucun sceptique sérieux ne nierait la différence de l'astrologie judiciaire et de l'astronomie, la différence entre les récits du passé, bien attestés, et les prévisions de l'avenir, du moins dans l'ordre moral ; et ces prévisions elles-mêmes on les distingue clairement des prédictions à coup sûr des savants. Si le pari, comme disait Kant, est un criterium, un vote de fonds en est un bien plus certain : or tous les Etats de l'Europe ont voté d'avance des fonds pour étudier le passage de Vénus sur le soleil ; tous les jours, au contraire, les paris engagés à la Bourse sont démentis par les événements.
Ainsi, quand même ce que nous appelons certitude n'aurait encore, au point de vue du métaphysicien, qu'une valeur relative, toujours est-il qu'il y aura une différence entre les mathématiques, et la météorologie, l'une qui expose la vérité sans aucun mélange de doute et avec une évidence nécessité, et l'autre qui ne possède que quelques données empiriques, sans aucune prévision certaine.
Telle est la distinction que la logique doit expliquer d'avance, si l'on veut bien comprendre la différence qui existe entre les différents procédés de l'esprit, par exemple entre la déduction et l'induction, entre l'induction elle-même et l'analogie, entre l'expérience et le témoignage, et ces distinctions sont essentiellement logiques ; mais en même temps il faut exclure de la logique le débat sur le fondement de la certitude, afin de ne pas engager cette science, qui est presque aussi exacte que les mathématiques, dans les disputes des métaphysiciens « Dans la plupart des logiques anciennes et même modernes, la question de la certitude est complètementomise. Dans le Compendium philosiphiae de Ganz ( Wolfien célèbre du XVIII° siècle), les mots de certum, evidens, ne se rencontre même pas. La logique de Whately, celle de Mill, celle de Bain, omettent également cette question. En revanche, dans sa logique, Uberweg introduit tout le problème métaphysique : il discute jusqu'à l'existence des corps. ( Logik, erster Theil, ch. 36-44 ). ».
A ce point de vue purement logique, les notions que nous avons à exposer sur la certitude sont très succinctes, et elles doivent l'être, pour éviter de tomber dans la question du scepticisme. Il n'en est pas de même de la probabilité, qui est exclusivement du domaine de la logique, et qui donne lieu à beaucoup plus d'observations intéressantes.
La certitude est l'état de l'esprit qui adhère à une proposition sans qu'il lui soit possible d'en douter : par exemple lorsque je pense, il me serait absolument impossible de penser que je ne pense pas ; lorsque je dis que deux quantités égales à une troisième sont égales entre elles, il me serait impossible de supposer qu'elles ne le sont pas. Enfin, lorsque j'ai posé que tous les hommes sont mortels, et que Socrate est un homme, il me serait impossible de supposer que Socrate n'est pas mortel. Il y a donc au moins trois cas où l'esprit jouit en fait de cette possession absolue et sans mélange de la vérité, ou de ce qu'il croit telle ; le contraire dans toutes ces hypothèses, est quelque chose d'impensable. C'est cet état de l'esprit que l'on appelle certitude. Dans la pratique, la certitude s'étend beaucoup plus loin : car la croyance à l'existence de la Ville de Rome, ou au lever du soleil, demain et les jours suivants, est certainement égale aux certitudes précédentes : mais les logiciens cependant ne la mettent pas sur le même rang ; et il nous importe peu quant à présent de savoir quelles sont les vérités certaines, mais seulement s'il y en a, et à quoi elles se reconnaissent.
292. L'évidence.
Lorsqu'une vérité est telle qu'il nous est impossible d'en douter, on dit qu'elle est évidente, et on compare avec raison la clarté et la lumière de la vérité à la lumière physique. De même que nous n'avons d'autre raison d'affirmer la lumière, si ce n'est que nous voyons, de même nous n'avons d'autre raison d'affirmer la vérité, si ce n'est que nous la voyons ; et ce ne serait pas une objection de dire que nous croyons voir la lumière, même quand il n'y en a pas, à savoir dans les rêves, dans les hallucinations : car nous ne verrions pas la lumière dans nos rêves si nous ne l'avions jamais vue réellement, et par conséquent nous ne percevrions jamais aucune lumière de vérité, si nous n'en avions jamais perçu auparavant. Demander une autre clarté que la clarté même de la vérité pour la prouver, c'est ne savoir ce qu'on demande « Spinosa, Ethique, II prop. XLIII. ».
On ne peut pas plus définir l'évidence que la prouver, mais on peut la remplacer par des mots équivalents : ainsi on dira avec Descartes que c'est une connaissance « tellement claire et tellement distincte que je ne puis la révoquer en doute ». Les anciens, la comparant à la lumière, comme nous l'avons déjà dit, l'appelaient fulgor mentis assensum rapiens.
La certitude ayant pour caractère essentiel l'impossibilité de douter, ou, comme on l'a dit, l'inconcevabilité du contraire « C'est ce que Herbert Spencer appelle le postulat universel ; dans Principes de psychologie, 7° partie, ch. XI. », on comprend que la certitude doit être absolue, et qu'elle ne peut avoir aucun degré : car si elle n'était pas absolue, si elle était plus ou moins grande, il y aurait quelque chance que la chose fût autrement que nous ne la pensons, et le caractère précédent viendrait à manquer.
293. Diverses espèces de certitude.
Quoique la certitude soit absolue, c'est-à-dire une, simple, indivisible,toujours semblable à elle-même partout où elle est, on peut cependant distinguer plusieurs espèces de certitudes, suivant les diverses facultés qui nous la donnent.
On distingue trois espèces de certitude : la certitude de fait ou physique, la certitude de raison ou démonstrative, et la certitude morale. ( Euler, Lettres à une princesse, LI.)
« Celle de la première source est appelée certitude physique. Quand je suis convaincu de la certitude d'une chose parce que je l'ai vue moi-même, j'en ai une certitude physique… C'est ainsi que je sais que les Autrichiens ont été à Berlin, et y ont commis beaucoup de désordres. »
La seconde certitude est appelée par Euler démonstrative parce qu'elle résulte, suivant lui, de la démonstration ; mais il faut comprendre la certitude des axiomes, qui n'a pas besoin de démonstration et qui résulte de l'inspection seule des idées sans recours à l'expérience. Nous verrons tout à l'heure qu'elle peut-être médiate ou immédiate.
Par certitude morale on a toujours entendu, dans les écoles, et c'est le sens d'Euler, la certitude fondée sur le témoignage des hommes quand il est indubitable, c'est-à-dire unanime : c'est ce que Bossuet appelle la croyance ou la foi. Rigoureusement parlant la certitude n'est peut-être pas ici la même que dans les cas précédents, et les logiciens n'y voient d'ordinaire qu'une probabilité infiniment grande : mais quand les effets de la probabilité sont absolument les mêmes que ceux de la certitude, il est légitime, au moins pratiquement, d'employer les mêmes termes : et il est sûr qu'on n'hésiterait pas plus à jouer sa vie sur le fait de l'existence de Rome que sur le théorème du carré de l'hypoténuse.
Dans l'usage, on emploi souvent le mot de certitude morale pour exprimer une conviction vive, quoique non suffisamment fondée : ainsi on dit qu'on acquittera un accusé malgré la certitude morale qu'il est coupable : mais c'est confondre la certitude proprement dite avec la croyance subjective : ce qui prouve qu'il n'y a pas de certitude dans ce cas, c'est qu'on ne jouerait pas sa vie sur cette carte. Ce n'est donc qu'au point de vue pratique que l'on peut dire avec Royer-Collard : « je n'en sais rien, mais j'en suis sûr. » Le mot de certitude ne peut s'employer que par hyperbole dans de pareils cas.
Doit-on employer le mot de certitude morale pour exprimer les croyances relatives à la morale ? Nous ne le pensons pas. Les affirmations relatives à la morale ne sont pas d'un autre ordre que les autres : elles sont toujours ou des faits, ou des principes, ou des déductions, ou des inductions, ou des croyances fondées sur le témoignage ; mais il n'y a pas de certitude propre aux choses morales.
L'évidence qui détermine la certitude peut être immédiate ou médiate. Elle est immédiate, lorsqu'elle n'a besoin d'aucun intermédiaire pour frapper l'esprit : c'est ce qui a lieu pour les facultés intuitives : c'est pourquoi on dit aussi qu'elle est intuitive, et on le dit également de la certitude.
L'évidence et par conséquent la certitude est médiate, lorsque, pour rendre une proposition évidente, il faut passer par plusieurs autres qui conduisent à celle-là.
La certitude ou l'évidence immédiate est celle de la conscience, des sens et des axiomes.
La certitude ou l'évidence médiate est celle du raisonnement (Voy. Plus haut, 166.)
294. De la probabilité.
Lorsqu'une question est posée et que je n'ai aucune espèce de données pour la résoudre, l'état de mon esprit par rapport à la solution s'appelle, nous l'avons vu, ignorance. Lorsque les données au contraire sont complètes ,qu'aucune d'elles ne fait défaut – soit dans la réalité, parce que je les connais toutes, soit dans ma pensée, parce que je fais abstraction de celles que je ne connais pas, - l'état de mon esprit s'appelle science par rapport à l'objet et certitude par rapport à moi-même.
Mais si les données ne sont ni toutes présentes, ni toutes absentes à la fois, l'état intermédiaire entre l'ignorance et la science s'appelle probabilité.
Par un caprice de langage, le mot probabilité s'applique aux opinions, aux jugements et par extension aux faits, mais non à l'esprit. On dit : Je suis certain, on ne dit pas : Je suis probable.
La probabilité des opinions a donc lieu lorsque le nombre des données qui servent à la solution d'une question n'est pas complet, et qu'il reste des inconnues ou des données contraires. Par exemple, fera-t-il beau demain ? D'une part, le temps est au beau depuis plusieurs jours : c'est une chance pour qu'il ne change pas tout à coup. Le vent est favorable : c'est une autre donnée. Mais j'ignore s'il n'y aura pas changement de vent : c'est une inconnue. Je sais que le vent a changé dans un pays voisin : c'est une donnée contraire.
Les données qui sont en faveur d'une solution s'appellent chances favorables ; les données qui sont opposées à celles-là sont des chances contraires. L'expression de chances convient surtout lorsqu'il s'agit d'un événement qu'on attend ; mais lorsqu'il s'agit d'une opinion, ce ne sont plus les chances que l'on oppose, ce sont des raisons ; et elles se partagent également en deux classes, les raisons pour et les raisons contre.
Lorsque les chances ou les raisons sont inégalement partagées, le parti qui a le plus de chances ou de raisons en sa faveur est dit le plus probable ( probabilius ), ou simplement probable ; l'autre est moins probable ( minus probabile ), ou improbable.
Quand les chances ou les raisons sont également partagées, et que l'équilibre est absolu ( ou quasi absolu ), l'état d'esprit, comme nous l'avons vu plus haut, s'appelle le doute : c'est celui qui a lieu lorsque les deux opinions sont également probables.
Le vraisemblable et l'invraisemblable ne diffèrent pas essentiellement du probable et de l'improbable. Ce sont des expressions qui appartiennent plutôt à la langue littéraire, et les autres ( probable, etc. ) à la langue de la logique.
Puisque la probabilité consiste à contre-balancer les données favorables avec les données défavorables, et que la probabilité augmente ou diminue avec le nombre des premières, on comprend qu'on puisse représenter par un nombre de chance d'un événement : c'est de là qu'est venu le calcul des probabilités. Sans doute, il s'en faut de beaucoup que dans tous les cas la probabilité puisse se représenter mathématiquement ; mais pour bien nous rendre compte de la probabilité logique, nous devons commencer par exprimer la probabilité mathématique.
« La théorie des hasards, dit Laplace ( essai philosophique sur les probabilités, p. 7 ), consiste à réduire tous les événements du même genre à un certain nombre de cas également possibles, c'est-à-dire tels que nous soyons également indécis sur leur existence, et à déterminer le nombre des cas favorables à l'événement dont on cherche la probabilité. Le rapport de ce nombre à celui de tous les cas possibles est la mesure de cette probabilité, qui n'est ainsi qu'une fraction dont le numérateur est le nombre de cas favorables et le dénominateur le résultat de tous les cas possibles. »
Par exemple, supposons, avec S'Gravesande ( Intro. A la phil., ch. XVII, 592 ),
« Qu'un homme sorte d'un vaisseau dans lequel il y aura 24 Hollandais, 12 Anglais et 4 Allemands : si j'ignore de quelle nationalité est cet homme, on demande quelle probabilité il y a que ce soit un Hollandais, un Anglais ou un Allemand. Tout le monde voit à première vue que la probabilité est en faveur des Hollandais ; mais le calcul des probabilités nous apprend quelle est la valeur exacte de cette probabilité. Le nombre de tous les cas, dans cet exemple, est de 100. Le degré de probabilité en faveur de chaque nationalité sera donc exprimé par le rapport du nombre de chacune au nombre total, par conséquent 84/100 pour les Hollandais, 12/100 pour les Anglais, 4/100 pour les Allemands, c'est-à-dire par le rapport 21 à 25 pour le premier cas, 3 à 25 pour le second, 1 à 25 pour le troisième. Je pourrai donc dire qu'il y a 21 chances contre 4 que l'homme en question sera Hollandais. ».
Tel est le principe du calcul des probabilités. Le développement de ce principe appartient aux mathématiques, non à la logique « Voy. Laplace : Principes généraux du calcul des probabilités, p. 12 et suiv. ».
D'après ce qui précède, voici comment l'on peut traduire mathématiquement tous les degrés d'assentiment : 1 ou n/n , c'est-à-dire le cas où le nombre des cas favorables est égal à celui de tous les cas possibles, représentera la certitude positive ou affirmative, à savoir, qu'il est certain que l'événement aura lieu ; 0 = 0/n représentera la certitude négative, à savoir l'absence de tous cas favorable, la certitude que l'événement n'aura pas lieu. ½ représentera l'équilibre ou l'égalité absolue des chances favorables ou des chances contraires. Toute fraction comprise entre ½ et 1 représentera la vraisemblance, ou la prédominance des chances favorables sur les chances contraires. Toute fraction entre ½ et 0 représentera l'invraisemblance ou le moins probable, la prédominance des chances contraires.
295. L'Espérance.
Lorsque nous croyons qu'un événement désiré a plus de chance de se produire que l'événement contraire, l'état de notre âme par rapport à cet événement s'appelle espérance. Dans le cas où les chances peuvent se mesurer, on a pu donner de l'espérance une définition mathématique.
« La probabilité des événements sert à déterminer l'espérance ou la crainte des personnes intéressées à leur existence. Le mot espérance a diverses acceptations : il exprime généralement l'avantage de celui qui attend un bien quelconque dans des suppositions qui ne sont que probables. Cet avantage, dans la théorie des hasards, est le produit de la somme espérée par la probabilité de l'obtenir : c'est la somme partielle qui doit revenir, lorsqu'on ne veut pas courir le risque de l'événement, en supposant que la répartition se fasse proportionnellement aux probabilités. Nous nommerons cet avantage espérance mathématique. »
296. Probabilité simple et probabilité composée.
On distingue la probabilité simple et la probabilité composée. Lorsque l'on recherche la probabilité d'un événement unique, c'est la probabilité simple. Lorsqu'on joint ensemble plusieurs probabilités simples, c'est alors la probabilité composée. Cette probabilité s'obtient, suivant les cas, tantôt par l'addition, tantôt par la multiplication des probabilités simples « Ces assurances, trop peu pratiquées en France, ne sauraient être trop généralisées ; Essai sur les probabilités, p. 162. »
297. Applications.
L'application du calcul des probabilités aux événements de la vie humaine a eu les plus heureuses conséquences : c'est sur ce calcul que repose l'institution des assurances simples « Ces assurances, trop peu pratiquées en France, ne sauraient être trop généralisées ; Essai sur les probabilités, p. 162. », qui permet à l'homme de maîtriser en quelque sorte le hasard en prenant des mesures contre lui : à l'aide d'un très petit risque, on évite un très grand mal. La plus belle et la plus utile de ces sortes de précaution est l'assurance sur la vie où, par une prime annuelle, on s'assure à soi-même un capital en cas de vie ou à sa famille en cas de mort. Ces sortes d'assurances sont fondées sur ce qu'on appelle les tables de mortalité.
Si le calcul des probabilités a de grands usages au point de vue pratique, il ne faut pas cependant en abuser et croire qu'il peut s'appliquer partout. Les mathématiciens ( et Laplace le premier ) en ont exagéré l'usage.
C'est une question, par exemple, de savoir si le calcul des probabilités est utilement applicable à la médecine :
« Pour connaître le meilleur des traitements en usage dans la guérison d'une maladie, dit Laplace, il suffit d'éprouver chacun d'eux sur un même nombre de malades, en rendant toutes les circonstances parfaitement semblables ; la supériorité du traitement le plus avantageux se manifestera de plus en plus à mesure que ce nombre croîtra ; et le calcul fera connaître la probabilité correspondante de son avantage et du rapport suivant lequel il est supérieur aux autres. »
Cette doctrine est contestée par Claude Bernard :
« Un grand chirurgien fait plusieurs opérations de taille par le même procédé. Il fait ensuite un relevé statistique des cas de mort et des cas de guérison, et il conclut que la loi de la mortalité dans cette opération est de deux sur cinq. Eh bien, je dis que ce rapport ne signifie absolument rien scientifiquement, et ne donne aucune certitude pour faire une nouvelle opération ; car on ne sait pas si ce nouveau cas sera dans les guéris ou dans les morts… Ce qu'il y a à faire, c'est d'examiner les cas de mort et de chercher à y découvrir la cause des accidents, afin de s'en rendre maître ( Cl. Bernard, Introduction à la médecine expérimentale. 2° partie, ch. II §XI) ».
C'est aussi à tord qu'on a voulu appliquer le calcul à l'appréciation du témoignage des hommes. 5 Voy. Plus loin sect. III, ch IX.).
Il y a donc des cas où la probabilité ne peut pas être réduite en nombres. C'est ce qu'on appelle la probabilité philosophique. La probabilité, dans ce cas, n'est sans doute pas arbitraire : car on ne peut pas penser ce qu'on veut, uniquement parce qu'on le veut ; elle repose sur des raisons, sur des faits, sur des indices, sur des témoignages, et elle est plus ou moins combattue par des raisons, des indices, des faits, des témoignages contraires. Quoiqu'on ne puisse pas mesurer et réduire en nombres exacts les élément du problème, il n'en est pas moins vrai que plus les données favorables sont nombreuses, plus la probabilité s'approche de la certitude, et réciproquement. Le procédé de raisonnement n'est plus ici le calcul ; c'est l'induction, l'analogie, la discussion contradictoire, ce que les Anglais appellent cross-examination. L'induction, dans les conditions que nous fixerons plus loin ( ch. Suivant ) est celui de tous les procédés qui s'approche le plus de la certitude, au point même que la probabilité s'y confond avec la certitude. Cette probabilité décroîtra avec les autres procédés.
« Par exemple, dit Cournot, telles théories physiques sont, dans l'état de la science, réputées plus probables que d'autres, parce qu'elles nous semblent mieux satisfaire à l'enchaînement rationnel des faits observés, parce qu'elles sont plus simples, ou qu'elles font ressortir des analogies plus remarquable ; mais la force de ces analogies, de ces inductions ne frappe pas au même degré tous les esprits, même les plus éclairés et les plus impartiaux… Ces probabilités changent par les progrès de la science. Telle théorie repoussée dans l'origine et ensuite longtemps combattue, finit par obtenir l'assentiment unanime. ( Essai sur les fondements de nos connaissances, ch. IV.) »
La jurisprudence a souvent besoin d'énumérer et de classer les divers degrés de probabilité qui peuvent déterminer le jugement. De là ce qu'on appelle la théorie des preuves.
« Les jurisconsultes, dit Leibniz, en traitant des preuves, présomptions, conjectures et indices, ont dit quantité de bonnes choses sur ce sujet, et sont allés à quelque détail considérable. Ils commencent par la notoriété, où l'on n'a point besoin de preuve. Par après ils viennent à des preuves entières, ou qui passent pour telles, sur lesquelles on prononce au moins en matière civile, mais où en quelques lieux on est plus réservé en matière criminelle ; et on n'a pas tort d'y demander des preuves plus que peines et surtout ce qu'on appelle corpus delicti selon la nature du fait. Il y a donc preuves plus que pleines, et il y a aussi des preuves pleines ordinaires. Puis il y a présomption, qui passent pour preuves entières provisionnellement, c'est-à-dire, tandis que le contraire n'est point prouvé. Il y a preuves plus que demi-pleines ( à proprement parler ) où l'on permet à celui qui s'y fonde de jurer pour y suppléer ; c'est juramentum suppletorium. Il y en a d'autres moins que demi-pleines, où tout au contraire on défère le serment à celui qui nie le fait pour se purger, c'est juramentum purgationis. Hors de cela, il y a quantité de degrés des conjectures et des indices. Et particulièrement en matière criminelle il y a indice ( ad torturam ) pour aller à la question ( laquelle a elle-même ses degrés marqués par les formules de l'arrêt ), il y a indice ( ad terrendum ) suffisant à faire montrer les instruments de la torture et préparer les choses comme si l'on voulait y venir. Il y en a ( ad capturam ) pour s'assurer d'un homme suspect, et ( ad inquirendum ) pour s'informer sous main et sans bruit. Et ces différences peuvent encore servir en d'autres occasions proportionnelles ; et toute la forme des procédures en justice n'est autre chose en effet qu'une espèce de logique appliquée aux questions de droit. Les médecins encore ont quantité de degrés et de différences de leurs signes et indications qu'on peut voir chez eux. »
La critique des témoignages, comme nous le verrons, repose également sur l'appréciation des degrés de probabilité. ( Sect. II, ch. IV. )
298. Probabilité morale.
Dans la théologie morale, les casuiste ont eu souvent à comparer les opinions d'après leur degré de probabilité. Ils ont distingué deux espèces de probabilités : l'une extrinsèque, l'autre intrinsèque ; la première fondée sur l'autorité, la seconde sur des raisons. La seconde est évidemment supérieure. Comme l'a dit Pascal plaisamment, il faut, pour trancher une question non des moines, mais des raisons. Cependant l'autorité extérieure est loin d'être sans valeur, et l'autorité « d'un docteur grave » suffira pour rendre une opinion sinon plus probable qu'une autre, au moins assez probable pour mériter l'examen. Ainsi, il suffira qu'un homme comme Montesquieu ait eu une opinion, pour qu'il y ait lieu de discuter cette opinion « Sur la logique du probable, voy. Un important mémoire de M. Charpentier. ( Comptes rendus de l'Académie des sciences morales, avril-mai 1875.) ».
CHAPITRE II
Les principes du raisonnement.
On appelle lois formelles de l'esprit les lois inhérente à la nature de la pensée, et qui sont indépendantes de l'existence de tout objet.
Ces lois sont les principes logiques, sans lesquels il est impossible de raisonner et même de penser ( 183 ). Nous devons donc les étudier avant tout le reste, comme étant les conditions à priori de tout acte logique, comme les axiomes mêmes de la logique.
299.Les trois principes de la pensée.
Toute la raison humaine est dominée par un principe fondamental, l'accord de la pensée avec elle-même ; et ce principe lui-même se décompose en deux autres : le principe d'identité ( principium identitatis ) et le principe de contradiction ( principium contradictionis ), auxquels on ajoute souvent un troisième principe qui se dédit du précédent : le principe du tiers exclu ( exclusi tertii ).
300. Principe d'identité.
Le principe d'identité, le plus simple de tous, exprime la nécessité, pour la pensée, que chaque terme soit conçu comme identique à lui-même c'est-à-dire comme ne changeant pas au moment où on le pense et en tant qu'on le pense. Car si, au moment où je dis : Pierre est un homme, le sujet Pierre venait à changer quand je pense à l'attribut ; ce que je dis du premier sujet pourrait ne plus être vrai du second ; il en est de même de l'attribut, si l'idée de cet attribut changeait en même temps que je le pense.
On a exprimé le principe d'identité de beaucoup de manières différentes. La plus simple et la plus abstraite est celle-ci : A est A ; c'est à dire : toute chose est elle-même, et que l'on exprime encore en disant : tout sujet est son propre prédicat : omne subjectum est proedicatum sui.
On n'énoncerait pas un autre principe, mais le même sous forme négative, si on disait : non-A est non-A , seulement, dans cette formule le sujet est un concept négatif ; mais ce qui est vrai du concept positif est vrai aussi du concept négatif.
Un corollaire du principe d'identité est ce que l'on appelle le principe de convenance ( principium convenientioe, Uberweg, Logik § 46 ), qui se formule ainsi : A qui est B, est B ; c'est-à-dire que tout caractère contenu dans la compréhension du sujet lui convient comme attribut. Ainsi le principe d'identité dit simplement : la neige est la neige. Le principe de convenance dit : tout ce qui est blanc est blanc.
On a fait valoir contre le principe d'identité que ce principe est une tautologie absolument vide, et qui ne nous apprend rien.
On ne soutient pas que le principe d'identité nous apprenne quelque chose, mais seulement qu'il est la condition sous-entendue de toute pensée, à savoir : je pense ce que je pense.
D'ailleurs, il n'est pas aussi infécond qu'on le soutient : car il peut servir à prouver que les choses ne sont pas un mouvement absolu. En effet, si tout changeait sans cesse, ma pensée changerait au moment même où je la pense, et dès lors je ne penserais pas du tout. Mais ce n'est pas ici le lieu d'engager cette discussion, qui appartient à la métaphysique ; il nous suffit, au point de vue logique, de montrer que l'on ne peut nier le principe d'identité sans nier la pensée elle même. Sans doute Hegel ( Logique, § 115 ) a raison de dire que nul ne se dit à soi-même, ni ne dit aux autres : Une plante est une plante ; une planète est une planète ; mais on le pense sans y penser, et on ne le remarque pas, parce que cela est inutile. Mais cela est inutile précisément parce que c'est la loi fondamentale de la pensée.
301. Principe de contradiction.
Le second principe de la logique est le principe de contradiction ( principium contradictionis). Il signifie que deux propositions dont l'une nie ce que l'autre affirme, ne peuvent être vraies ensemble : en d'autres termes, on ne peut à la fois nier et affirmer la même chose.
Ce principe se formule de cette manière : « Une même chose ne peut pas à la fois être et n'être pas » ou bien « A ne peut pas être à la fois A et nonA » ; c'est-à-dire qu'une chose ne peut pas être à la fois elle-même et son contraire « Hamilton a tort de dire que ce principe devrait se nommer principe de non contradiction, puisqu'il ordonne de ne pas se contredire ; mais ce principe n'est pas un précepte, c'est un loi, qui signifie que le contradictoire est le signe du faux. ».
Cependant, pour que ce principe soit indubitable, il faut y ajouter plusieurs caractères ; car la contradiction ne serait pas une vraie contradiction si dans les deux propositions il ne s'agissait pas du même sujet. Or, un même sujet pris en deux moments différents n'est pas le même sujet et, par conséquent, il peut avoir des attributs opposés ; on ajoutera donc au principe de circonstance : en même temps « Kant a fait cependant remarquer avec raison que la condition en même temps ne paraît nécessaire que parce qu'on formule mal la proposition. Par exemple, si on dit : un homme qui est ignorant n'est pas instruit, il faut ajouter en même temps, parce que celui qui est ignorant aujourd'hui peut devenir instruit dans un autre temps. Mais si je dis : nul ignorant n'est instruit, je n'ai pas besoin du concept de temps. ». De plus, un sujet complexe peut avoir plusieurs attributs opposés l'un à l'autre : un homme peut être à la foi sage et non sage, suivant la circonstance et le point de vue où l'on se place, sage comme homme public, non sage comme homme privé, etc. ; et il faudra donc ajouter que le sujet soit considéré sous le même point de vue, et le principe complet sera de cette façon : « Le même attribut ne peut pas en même temps convenir et ne pas convenir au même sujet, considéré au même point de vue et sous les même rapports. »(Aristote, Métaphys. , IV, 3.)
Hegel a contesté la valeur du principe de contradiction comme loi absolue de la pensée : il n'y voit que la loi toute relative de l'entendement, c'est-à-dire de la pensée discursive et abstraite, qui n'est pas la pensée absolue. Il soutient que cette loi est contraire à l'essence même de la proposition, où l'attribut est nécessairement différent du sujet ; toute pensée qui reposerait sur une identité absolue, serait vide ; elle ne se remplit, suivant Hegel, qu'en passant du contraire au contraire, par une série de degrés, la pensée absolue étant la conciliation de tous ces contraires.
La discussion de cette doctrine appartient à la métaphysique. Quant à la question actuelle, il suffira de dire que :
1° Hegel confond le contraire et le contradictoire ;
2° Il confond l'opposition réelle avec la contradiction logique.
On peut encore appliquer le principe de contradiction, soit :
1° A une notion séparée (notio contradictionem involvens) ;
2° A l'union d'un sujet et d'un attribut (contradictio in adjecto).
Mais dans tous ces cas on peut toujours réduire la contradiction à deux propositions qui s'excluent l'une l'autre.
302. Principe du tiers exclu.
Le principe du tiers exclu consiste en ce que deux propositions contradictoire ne peuvent être fausses toutes les deux ; c'est-à-dire que si l'une est fausse, l'autre est vraie : il n'y a pas de milieu.
Mais pour que cette loi soit absolue, il faut bien entendre qu'il s'agit de propositions contradictoires, et non de propositions contraires ; c'est-à-dire, qu'il faut que les deux propositions soient opposées à la fois en quantité et en qualité, et non pas seulement en quantité ( voy. Plus loin ch. IV). En effet, deux propositions qui ne sont que contraires ne peuvent être vraies ensemble, mais elles peuvent être fausses toutes les deux. Par exemple : tout homme est sage, nul n'est sage, sont deux propositions fausses, car il y en a une troisième possible, à savoir : quelques hommes sont sages ( ce qui implique que quelques-uns ne le sont pas).
Si, au contraire, je dis : tout homme est sage, quelques hommes ne sont pas sages, il faut que de ces deux propositions l'une des deux soit vraie, toute troisième est exclue, parce que, évidemment, s'il est faux que tout homme soit sage, cela ne peut être faux que parce qu'on admet que quelques-uns ne le sont pas ; et réciproquement, s'il était faux de soutenir qu'il y a des hommes qui ne sont pas sages, ce serait évidemment parce que l'on admettrait que tous le sont.
Il semble cependant qu'il y ait des propositions vraiment contradictoire et qui cependant ne diffèrent qu'en qualité, et non en quantité ; par exemple : le monde est infini, le monde n'est pas infini. Il n'y a pas de milieu, et cependant le sujet a la même quantité dans les deux propositions.
Al. Bain, après Hamilton, a très bien expliqué dans sa Logique cette apparente contradiction. Il dit que quand le sujet est individuel, les contraires et les contradictions se confondent ; par exemple : César est mort, César n'est pas mort. Car il ne peut pas se faire qu'il y ait une partie du sujet qui ait tel attribut et telle autre partie un autre attribut, puisque le sujet est indivisible. Il en sera de même si je considère le sujet comme un tout indivisible et individuel : le monde, l'âme, la matière, la liberté « Bain, Logique ( trad. Fr. , t. I, p. .).
Cette propriété des négatives particulières pour détruire les universelles affirmatives est d'un immense avantage dans la réfutation, et dans la discussion contradictoire.
303. Principe métaphysique.
Doit-on, dans la logique, étudier les autres principes que nous avons appelés plus haut les vérités premières, par exemple, le principe de causalité, le principe de raison suffisante, comme l'on fait plusieurs logiciens allemands ? « Par exemple Uberweg. Cet auteur défend ce qu'il appelle la logique réelle contre la logique formelle. Il prétend que la logique doit s'occuper de l'objet aussi bien que de la forme de la pensée ; mais il devient impossible alors de distinguer la logique de la métaphysique. » Non : ce sont là des principes métaphysiques, non logiques ; ils ont rapport à l'objet, et non aux lois essentielles du sujet.
CHAPITRE III
Les idées et les termes.
Après avoir traité des principes du raisonnement, nous serions appelé naturellement à parler du raisonnement lui-même. Mais le raisonnement se compose de jugements, et le jugement se compose d'idées ; c'est ce qu'on appelait autrefois dans les écoles les trois opérations de l'esprit, et nous devons parler des deux premières avant de nous occuper de la troisième.
304. Des trois opérations de l'esprit, et de la première, la conception.
L'ancienne logique distinguait donc trois opérations fondamentales de l'entendement : concevoir, juger et raisonner.
« Autre chose est, dit avec raison Bossuet, d'entendre les termes dont une proposition est composée, autre chose de les assembler ou de les disjoindre. Par exemple, dans ces deux propositions : Dieu est éternel, l'homme n'est pas éternel, c'est autre chose d'entendre ces termes, Dieu, homme ,éternel, autre chose de les assembler ou de les disjoindre, en disant : Dieu est éternel, ou l'homme n'est pas éternel.
Entendre les termes, par exemple, entendre que Dieu veut dire la première cause, qu'homme veut dire animal raisonnable, qu'éternel veut dire ce qui n'a ni commencement ni fin, c'est ce qui s'appelle conception, simple appréhension, et c'est la première opération de l'esprit Voy. Bossuet, Connais. De Dieu et de soi-même, ch. I, XIII. La logique de P.-Royal les reconnaît également, mais aux trois premières : concevoir, juger, raisonner, elle en ajoute une quatrième : ordonner. Molière fait allusion plaisamment à cette théorie dans le Bourgeois gentilhomme : ( Qu'est-ce que c'est que cette logique ? C'est elle qui enseigne les trois opérations de l'esprit. Qui sont-elles ces trois opérations de l'esprit ? La première, la seconde et la troisième. Acte II, sc. VI.) ».
Cette distinction est admise par les plus récents logiciens.
« Tout acte de croyance, dit Stuart Mill, implique la représentation de deux objets ; mais chacun pris à part peut être on n'être pas concevable, mais n'est susceptible ni d'affirmation, ni de négation. Je peux, par exemple, dire : le soleil ; ce mot a pour moi un sens, et il a le même sens dans l'esprit de celui qui me l'entend prononcer. Mais je suppose que je lui demande : Est-ce vrai ? Le croyez-vous ? Il ne peut donner de réponse. Il n'y a rien là à croire ou à ne as croire. ».
Un dictionnaire nous fournit l'exemple de ce que les logiciens appelaient simple appréhension ou conception. En effet, quand je parcours un dictionnaire, chaque mot a un sens, mais non pas un sens complet, et n'implique aucune affirmation, vraie ou fausse. Quand je dis aimer, amare, je sais ce que cela signifie ; mais je ne prononce rien, je ne dis rien, je ne crois rien, tant que je ne fais que prononcer le mot. Pour que ma pensée ait un sens complet, il faut au moins deux mots, et il faut que ces deux mots soient réunis par le verbe est.
Deux objections peuvent être faites contre cette doctrine : la première, c'est que la conception n'est pas la première opération de l'esprit ; la seconde que la conception ne va jamais sans explication explicite ou implicite.
1° A la première objection nous répondrons que nous ne sommes plus ici en psychologie, mais en logique. Il ne s'agit plus de savoir quels sont, en fait, les premiers actes de l'esprit, mais quels sont, idéalement, les éléments de nos jugements. En fait, ce qui est donné d'abord est peut-être le jugement ; mais, pour l'analyse, les parties du jugement lui sont théoriquement antérieures. Le simple est logiquement antérieur au composé, quoiqu'il lui soit postérieur dans la réalité. Ainsi, le corps physique nous est donné dans l'expérience avant le solide géométrique, le solide avant le plan, les figures planes avant la ligne. Mais la géométrie part de la ligne pour s'élever aux figures planes et de celles-ci aux solides. Il en est de même des idées par rapport aux jugements :
« Entendre les termes, dit Bossuet, est chose qui précède naturellement les assembler, autrement on ne sait ce qu'on assemble. »
2° La seconde objection est qu'il n'y a pas de conception sans affirmation « C'est l'oppinion de DuDugald Stewart ( Eléments, t. I, ch. III) et de Spinosa ( Ethique, partie II prop. XVII, sclie, et prop. XLIV). Cela est vrai, mais cette affirmation inhérente à la conception n'y est qu'implicitement ; et la logique fait abstraction précisément de cette affirmation implicite et la subordonne à l'affirmation principale : c'est celle-ci seule que l'on considère. On peut même exprimer la première sans rien changer à la théorie précédente. Par exemple, je dirai : Dieu ( qui est la première cause ) est éternel. Il est évident que l'affirmation de la proposition incidente n'est que secondaire, et que je puis ne pas même l'exprimer, en disant par exemple : Dieu, c'est-à-dire la première cause, ou encore : la cause suprême, Dieu ; ce sera toujours une conception dont je n'affirme rien, si ce n'est que je la pense ainsi. On peut donc étudier la première opération séparément et avant la seconde ; il est même nécessaire de l'étudier auparavant, si l'on veut comprendre celle-ci, qui est le jugement, et qui consiste « à assembler ou à disjoindre les termes ».
Quant à la troisième, qui est le raisonnement, il nous suffit de dire ici avec Bossuet :
« Qu'elle consiste à se servir d'une chose claire pour en rechercher une obscure, à prouver une chose par une autre ; par exemple, prouver une proposition d'Euclide par une autre, ou prouver que Dieu hait le péché, parce qu'il est saint. »
Il sera temps d'expliquer cela en détail quand nous viendrons à l'analyse du raisonnement.
305. Idées et termes.
On appelle termes d'un jugement ou d'une proposition l'attribut et le sujet de cette proposition ou de ce jugement, et l'acte de l'esprit qui correspond à chacun de ces termes s'appelle idée.
Le terme est donc l'idée exprimée par des mots. On peut étudier l'idée abstraction faite du terme, ou bien étudier l'idée par le moyen du terme, ou enfin, comme Bossuet dans sa Logique, les distinguer l'un de l'autre et les étudier séparément.
306. Des idées.
Pour comprendre la nature de l'idée, il faut distinguer imaginer et entendre ( 149 ).
L'imagination nous fournit des images ; l'entendement seul fournit des idées.
L'image est la représentation d'une chose sensible et individuelle. L'idée est la représentation d'une chose intellectuelle.
Les choses intellectuelles sont de deux sortes : ce sont ou les choses spirituelles ou les universaux, c'est-à-dire les genres et les espèces.
Mais en logique, peu importe la distinction du matériel et du spirituel ; c'est là une distinction métaphysique, non logique. Le seul objet de la logique, c'est l'universel, et c'est de l'universel seul qu'il peut y avoir idée.
On peut dire sans doute que la logique n'exclut pas l'individuel, puisque beaucoup de propositions ou de raisonnements portent sur les individu. Mais nous verrons que cela importe peu au logicien ; il ne considère pas l'individu comme tel, et , logiquement parlant, les termes individuels ont exactement la même valeur que les termes généraux.
L'idée exprime donc ce qu'il y a de commun, d'universel de persistant dans une classe de choses, et par conséquent ce qu'il y a de vrai dans cette classe. ( Bossuet, Logique, ch. II. ).
307. Définition de l'idée.
De là cette définition de Bossuet : « L'idée est ce qui représente la vérité de l'objet entendu. » ( Logique, ch. III.) Par exemple, l'idée du triangle n'implique pas qu'il soit en bois ou en fer, car cela est indifférent, et il peut subsister sans cela ; ni qu'il soit grand ou petit, car il sera toujours triangle de quelque grandeur qu'il soit. Peu importe aussi qu'il ait ou qu'il qu'il n'ait pas tous ces côtés égaux, car il peut être triangle sans cette condition. L'idée de triangle comprend tout ce qui est nécessaire pour qu'il soit triangle, mais rien de plus ( à savoir, trois angles et trois côtés ). C'est là ce qu'il y a de vrai dans le triangle, et ce qui exprime cette vérité sera l'idée du triangle.
Cette définition bien comprise, on pourra l'appliquer même aux choses individuelles, et en ce sens il pourra y avoir une idée des choses individuelles. Ainsi l'idée de Socrate sera l'idée d'un sage ayant eu le premier la notion du vrai Dieu ; cette idée exprime la vérité de Socrate, c'est-à-dire ce qu'il y a d'essentiel dans Socrate, et c'est en vertu de cette idée que nous jugerons qu'il a été injustement condamné. Même les êtres d'imagination peuvent avoir leur idée : ainsi Don Quichotte a si bien son idée en nous, que si quelque part, dans un drame ou une comédie, on nous le représentait commettant un acte de bassesse ou de lâcheté, nous serions aussi choqués que si on nous parlait d'un triangle équilatéral qui ne serait pas équiangle.
308. Objections.
A cette belle définition de Bossuet, on pourrai opposer :
1° Qu'elle implique la théorie des idées représentatives, généralement abandonnée « La théorie des idées représentatives suppose que les idées sont les images des objets, et qu'elles servent d'intermédiaire entre les objets de l'esprit. Cette théorie a été réfutée r Reid et Royer-Collard. Voy. Aussi Cousin ( Philosophie de Locke, 22° leçon). » ;
2° Qu'en parlant de la vérité de l'objet, Bossuet semble contredire la théorie reçue, même par lui, à savoir, que l'idée n'est ni vraie, ni fausse, et que la vérité n'appartient qu'au jugement.
A cette double objection, voici ce que l'on peut répondre :
1° La théorie des idées représentatives n'a été nié que par rapport à la perception extérieure ; c'est seulement au moment même où je perçois un objet, qu'il faut exclure tout intermédiaire, toute image entre l'objet et ma perception. Mais lorsqu'il s'agit des idées, c'est-à-dire des conceptions ou des souvenir de l'objet, nul doute que ces idées ne soient que très légitimement dites représentative de l'objet « C'est ce que soutient Hamilton, l'adversaire le plus décidé de la théorie représentative. ( Fragments. Art. REID ET BROWN, trad. Fr., p. 75 ) », soit immédiatement, s'il s'agit d'images individuelles, soit médiatement, s'il s'agit de concepts généraux.
2° Sur le second point, nous répondrons que nous avons déjà reconnu qu'il y a dans l'idée une affirmation implicite ; mais tant que cette affirmation n'est qu'implicite, l'idée reste à l'état d'idée, et peut être sujet ou attribut d'un jugement. Lorsque cette affirmation devient explicite, et que notre objet est précisément de l'exprimer ( et c'est ce qui a lieu dans la définition), l'idée prend elle-même la forme d'une proposition « C'est pourquoi la définition est placée par les logiciens tantôt dans la première, tantôt dans la seconde opération. ».
Ainsi lorsqu'on soutient, avec la plupart des logiciens, que l'idée n'est ni vraie, ni fausse, cela veut dire que nous n'affirmons rien autre chose en la concevant, si ce n'est qu'elle est ce que nous la concevons. Hors cette affirmation implicite, qui est la conception même, nous n'ajoutons rien de plus ; et par conséquent il n'y a ni vérité, ni erreur. Mais ce qui prouve qu'il y a là néanmoins une vérité sous-entendue, c'est que nous nous refusons à une conception contradictoire. Par exemple, si quelqu'un nous dit : un cercle carré, nous l'arrêtons immédiatement, sans attendre qu'il prononce un jugement et qu'il ajoute un verbe, car sa conception est déjà par elle-même impossible ; ce n'est pas, si l'on veut, une idée fausse, mais c'est une non-idée ; et on réfutera très bien un adversaire en discutant les idées qu'il avance, sans avoir même besoin d'aller jusqu'à la discussion des jugements : il suffira de montrer que ces idées sont contradictoires. Il y a donc au moins une vérité impliquée dans toute notion et dans toute idée, c'est que son objet est possible, c'est-à-dire non contradictoire.
Or, c'est cette vérité intrinsèque de l'idée que la logique considère, et pas autre chose.
On voit par ces explications ce que signifie cette définition de Bossuet : L'idée est ce qui représente la vérité de l'objet entendu.
309. Conséquences de la définition précédente.
Quelles sont maintenant les conséquences de cette définition ?
Bossuet en tire les trois propositions suivantes :
1°A chaque objet chaque idée.
2° Un même objet peut être considéré diversement.
3° Divers objets peuvent être considérés sous une même raison et être entendus par une seule idée.
Première proposition. Il n'y a qu'une idée de chaque objet. Voici comment il faut entendre cette proposition. Etant donné un objet, il n'est un qu'en tant qu'il est entendu par une seule idée. Ainsi une armée est une collection d'homme disciplinés, chargés de défendre la patrie ; s'il y avait deux idées, ce seraient deux objets et non un seul ; par exemple, d'une part l'idée du général, de l'autre l'idée des soldats. Il ne faudrait pas dire qu'un seul objet peut contenir deux idées, par exemple que, dans la définition du triangle, il entre d'un côté l'idée de trois angles, de l'autre l'idée de trois côtés ; car ces deux idées sont tellement jointes qu'elle n'en forment qu'une seule, puisqu'on ne peut se représenter un triangle qui n'ait pas à la fois trois angles et trois côtés. De plus, l'idée de l'objet doit l'épuiser tout entier, et « contenir tellement le tout que le reste n'est plus rien ». Ainsi l'idée du triangle contient en elle-même tout ce qui pourra être dit du triangle.
Seconde proposition. Quoiqu'il n'y ait qu'une idée pour chaque objet, cette idée pourra se multiplier suivant les points de vue que l'on considère dans l'objet. Par exemple, l'idée de l'âme prise en elle-même sera l'idée d'une chose qui pense : cette idée n'a qu'un objet, l'âme ; et l'âme n'est représentée que par cette idée, et par nulle autre. Mais je puis considérer l'âme à différents points de vue, et je l'appellerai de différents noms suivant ces points de vue ; et ainsi, en tant qu'elle sent, ce sera l'âme sensitive, en tant qu'elle pense, l'âme raisonnable. De même, quoique l'idée du corps soit l'idée d'une chose étendue, je puis décomposer cette idée et y distinguer la longueur, la largeur, la profondeur.
« Ainsi, à mesure que les objets peuvent être considérés, en quelque façon que ce soit, comme différents d'eux-mêmes, les idées qui les représentent sont multipliées, afin que les objets soient vus par tous les endroits qu'ils le peuvent être. »
Troisième proposition. De même qu'un seul objet considéré sous plusieurs raisons ou rapports peut donner lieu à plusieurs idées, de même plusieurs objets, considérés sous une même raison, peuvent être réunis sous une seule idée. C'est ce que l'on appelle l'universel.
Ainsi, dit Bossuet, quand je considère plusieurs cercles, je considère en réalité plusieurs objets. L'un sera plus petit ; l'autre plus grand ; ils seront diversement situés ; l'un sera en mouvement ; l'autre en repos, etc. Mais tous, aussi bien le plus grand que le plus petit, celui qui est en repos aussi bien que celui qui est en mouvement, ont tous les points de leur circonférence également éloignés de leur centre. A les regarder en ce sens, et sous cette raison commune, ils ne font tous ensemble qu'un seul objet et sont connus sous la même idée. Il en est de même de plusieurs hommes et de plusieurs arbres, qui sont tous compris dans la même idée d'homme et d'arbre.
310. De l'universel.
La propriété qu'a une idée de convenir à plusieurs objets s'appelle l'universalité, et l'idée qui a cette idée s'appelle universelle.
Bossuet explique quelques-unes des propriétés de l'idée universelle, dont les unes appartiennent à la logique et les autres plutôt à la métaphysique « C'est à la métaphysique qu'il appartient de décider que l'universel n'existe que ( dans la pensée) XXX ; que non datur universale à parte rei XXXI ; que les essences existent en Dieu XXXVII, que ( en toutes choses, excepté en Dieu, l'idée de l'essence et l'idée de l'existence sont séparées, etc. ». Nous nous bornerons à celles qui regardent la logique.
1° C'est un axiome de l'école que les essences ou les raisons propres des choses sont indivisibles, c'est-à-dire que les idées qui conviennent à plusieurs choses ; leur conviennent également ainsi la raison de cercle convient également au plus grand comme au plus petit, à celui qui est en repos comme à celui qui est en mouvement. Descartes a exprimé la même idée en disant ( Disc. De la méthode, partie I ) « qu'il n'y a de plus ou de moins que entre les accidents, et non entre les formes ou natures des individus d'une espèce ». Ce que Descartes appelle ici forme et nature, c'est l'idée universelle ou essence ( 328 ), à savoir, celle qui exprime ce qu'il y a de commun entre plusieurs objets.
2° Toutes nos idées sont universelles, et les unes plus que les autres.
Pour bien comprendre cette proposition, il faut savoir que, pour Bossuet, quoique tout soit individuel dans la nature, il n'y a pas cependant d'idée de l'individu « Nous avons vu plus haut (324) en quel sens, cependant, il serait vrai de dire qu'il y a une idée de l'individu. », c'est-à-dire que l'individu ne peut être connu que par la perception directe ; mais il ne peut pas être entendu et compris en tant qu'individu. Ainsi je puis faire comprendre à un autre homme ce que c'est qu'un cercle, mais je ne puis lui faire connaître Pierre ou Paul qu'en les montrant, ou tout au plus par leur portrait. Hors de là, je n'ai à ma disposition pour dépeindre un individu qu'un certain nombre d'idées universelles diversement combinées. Ainsi le signalement d'un individu, le portrait d'un personnage historique n'est que la combinaison de plusieurs qualités générales ; et c'est la diversité des mélanges qui nous permet de nous faire quelque idée de l'individu, mais cette idée n'est jamais qu'incomplète et éloignée. On peut encore prouver la même vérité en disant, avec Bossuet, que tout peut être semblable entre deux individus, excepté le nombre. C'est ce qu'on appelle la différence numérique. Deux cercles peuvent être absolument identique, et cependant ce sont deux cercles ; d'où il suit qu'au delà des différences perceptibles « il y a une distinction plus substantielle et plus foncière, mais en même temps inconnue à l'esprit humain » : ce fond inconnu est ce que la scolastique appelait le principe d'individuqtion. Sans nous enfoncer dans cette recherche, qui appartient à la métaphysique, disons que nous avons déjà établi en psychologie ( 96 ) que le propre objet de l'entendement est l'un dans le multiple, et par conséquent l'universel. Toutes les idées sont donc universelles. Elles le sont seulement les unes plus que les autres, car les unes conviennent à plusieurs objets qui ne diffèrent qu'en nombre ( triangle rectiligne ), d'autres à plusieurs choses qui diffèrent en espèce ( le triangle en général).
3° La plus noble propriété des idées est que leur objet est une vérité éternelle.
« Cela suit des choses qui ont été dites : car, si toute idée a une vérité pour objet, si, d'ailleurs, cette vérité n'est pas regardée dans les choses particulières, il s'ensuit qu'elle n'est pas regardée dans les choses comme naturellement existantes, parce que tout ce qui existe est particulier et individuel.
De là suit encore que les idées ne regardent pas la vérité qu'elles représentent comme contingente, c'est-à-dire comme pouvant être et n'être pas, et que, par conséquent, elles la regardent comme éternelle et absolument immuable ».
Pour bien comprendre cette doctrine, il faut distinguer la logique de la métaphysique ( ce que Bossuet ne fait pas assez). En métaphysique, c'est-à-dire au point de vue objectif, on peut se demander si nos idées correspondent à des types éternels et absolus, comme le voulait Platon. Bossuet admet cette doctrine, mais il nous semble qu'elle n'est pas nécessaire ici. Quand même on n'admettrait pas qu'il y ait un type réel et effectif d'un père ou d'un fils, et que ces deux conceptions ne sont que dans la pensée, toujours est-il qu'à l'idée de père est jointe l'idée de quelqu'un qui aime ses enfants, et à l'idée de fils, l'idée de quelqu'un qui aime son père, de sorte que nous disons d'un père qui n'aime pas ses enfants ou d'un fils qui n'aime pas son père, que ce n'est pas un vrai père, ni un vrai fils.
C'est dans ce sens que hegel, ici entièrement d'accord avec Bossuet, définit la vérité l'accord d'un objet avec son idée.
Laissant donc de côté le point de vue ontologique, nous disons que, logiquement, on ne peut raisonner, démontrer quelque chose qu'en s'appuyant sur des idées fixes et déterminées, et qui expriment, par conséquent, quelque chose d'absolu et d'éternel. Ainsi, comment saurais-je si les hommes doivent être gouvernés par la force ou par la raison, si je ne pars pas d'une idée certaine et fixe, qui sera la vérité de l'homme, par exemple, que c'est « une substance intelligente créée pour vivre dans un corps » ( Bossuet) ? D'où je conclurai que l'homme doit être gouverné essentiellement par la persuasion et accidentellement ou subsidiairement par la force ; et cela resterait éternellement vrai, lors même que l'humanité cesserait d'exister.
Objection. On dira que les choses, sans cesser d'être ce qu'elles sont, peuvent changer continuellement de nature, de telle sorte qu'aucune idée absolue et immuable n'en est la véritable expression, et , par conséquent, qu'aucune idée n'exprime une vérité éternelle. Il n'y a pas une idée de l'homme en général, mais il y a des hommes changeant sans cesse de nature suivant les temps et suivant les lieux : « Je n'ai jamais vu l'homme, disait J. de Maistre ; j'ai vu seulement des Anglais, des Français, des Russes, et des Allemands. »
Rep. Nous répondrons que si l'on admettait à la rigueur le point de vue précédent, toute logique et même toute pensée serait impossible « c'est ce que Platon démontre de la manière la plus profonde dans son dialogue du Théétète. » : car penser, étant un acte déterminé, suppose un objet qui reste fixe pendant qu'on le pense ; si cet objet changeait en même temps que je le pense, ma pensée changerait avec lui, et on ne trouverait jamais aucun terme fixe. Il faut donc pour que la pensée soit possible, admettre qu moins une fixité relative, et entre les attributs changeants des êtres une certaine moyenne constante qui sera considérée comme fixe pendant qu'on la pensera. Cette moyenne constante des écoles empiriques correspondra à l'idée absolue des écoles rationalistes et constituera, au point de vue subjectif et formel, ce que Bossuet appelle la vérité éternelle quant à l'objet. Par exemple, la même définition de l'homme pourra être donnée à la fois par les deux écoles, soit qu'on considère l'essence comme une fois donnée, ou comme une idée en mouvement, et c'est ce qu'on appellera dans les deux hypothèses, l'essence de l'homme.
311. Des essences.
« L'essence des choses, dit Bossuet, est ce qui répond premièrement et précisément à l'idée que nous en avons. » Ainsi l'essence est d'abord ce que nous concevons de premier dans chaque chose, c'est-à-dire ce qui ne suppose rien et dont tout le reste s'ensuit. Locke définit de la même manière l'essence en disant qu'elle est dans une chose « Le fondement de toute les qualités qui entrent dans l'idée complexe que nous en avons » ; et quoiqu'il prétende que l'essence ainsi entendue nous est inaccessible, on peut dire que nous en approchons plus ou moins, et que ce qui dans chaque chose nous paraît premier, est véritablement pour nous l'essence de cette chose.
Bossuet dit encore que c'est ce que nous concevons précisément dans un objet, c'est-à-dire ce qui appartient « à un objet sans appartenir à un autre », et qui appartient tellement à cet objet, que nous ne pouvons le penser sans cette condition. Il arrive en effet souvent que nous appliquons à un objet des attributs qui lui sont communs avec d'autres, ou des attributs qu'il ne possède pas toujours ni partout : ce n'est pas là l'idée précise de cet objet, ce n'est pas son essence ; mais ce qui n'est qu'à lui, et ce qui lui appartient partout et toujours, voilà ce qui lui est essentiel.
L'essence sera donc définie l'idée première et précise de chaque objet.
Locke distingue deux sortes d'essences, l'essence nominale et l'essence réelle. Mais cette distinction, en tant qu'elle intéresse la logique, sera mieux placée dans la théorie de la définition.
312. De la clarté et de la distinction des idées.
Depuis Descartes, la clarté et la distinction des idées ( ou évidence ) a été donné comme criterium de la certitude. Il importe donc de savoir ce que c'est que des idées claires et distinctes L'idée claire est celle qui se distingue nettement d'une autre idée : ainsi l'idée de plaisir ou l'idée de douleur sont des idées claires, parce qu'elle se distinguent nettement l'une de l'autre. L'idée distincte est celle dont on distingue nettement les différents éléments : par exemple, l'idée de cercle est une idée distincte, parce que nous en connaissons les éléments, à savoir, l'idée de surface, l'idée de ligne courbe qui enferme cette surface, et enfin l'idée de l'égalité des rayons. Une idée distincte ne peut pas ne pas être claire, mais une idée claire peut ne pas être distincte « Voy. Leibniz, méditations sur les idées ». A l'idée claire s'oppose l'idée obscure, et à l'idée distincte s'oppose l'idée confuse.
313. Différentes espèces d'idées.
D'après tout ce qui précède, nous pouvons nous borner à une simple énumération des différentes espèces de nos idées.
On les divisera, suivant la Logique de Port-Royal ( partie I ) :
1° Selon leur nature et leur origine. A ce point de vue, on distinguera les images et les idées ( 149 ), les idées sensibles et les idées intellectuelles ;
2° Selon leurs objets : les idées de choses ou substantifs, et les idées de mode ou adjectifs ;
3° Idées composées et idées simples : les idées composées ou complexes sont celles qui se composent de plusieurs éléments ; les idées simples sont celles qui ne peuvent être réduites à d'autres idées : par exemple, temps, être, unité, etc. ;
4° Selon leur généralité, particulière et singulière ;
5° Selon la clarté et la distinction, l'obscurité et la confusion. ( Voy. Le § précédent.)
LES TERMES.
Quoique la logique soit l'art de penser, et qu'elle ait pour objet propre les idées, cependant les logiciens ont toujours trouvé plus commode de considérer l'expression des idées que les idées elles-même. L'idée exprimée est ce qu'on appelle le terme. C'est de même que tout ce qu'ils ont à dire sur les jugements ils l'appliquent aux propositions, et sur les raisonnements, aux syllogismes. Il serait aussi impossible au logicien de faire la logique sans les mots, qu'au mathématicien de faire l'arithmétique sans les noms de nombre.
Ainsi le terme est « ce qui signifie l'idée », et de même que les idées sont les éléments du jugement, de même les termes sont les éléments de la proposition. Ainsi tout ce qu'on dit des termes peut se dire des idées, mais tout ce qu'on dit des idées ne se dit pas des termes ; c'est pourquoi, avec Bossuet, nous avons considéré d'abord les idées pour considérer ensuite les termes avec tous les logiciens.
314. Division des termes.
Bossuet divise les termes en :
1° Positifs ou négatifs ;
« Le positif est celui qui met et qui assure : par exemple, vertu, santé ; le négatif est celui qui ôte et qui nie : par exemple, ingrat, incurable. »
2° Abstraits ou concrets :
« Les termes abstraits sont ceux qui naissent des précisions ( abstractions), et ils signifient les formes détachées par la pensée de leur sujet ou de leur tout, comme quand je dis science, vertu, humanité, raison.
Les termes concrets regardent les formes unies à leur sujet et à leur tout comme quand je dis : savant, vertueux, homme et raisonnable. »
3° Complexes ou incomplexes :
« Les termes complexes sont plusieurs termes unis qui, tous ensemble, ne signifient que la même chose, comme si je dis : celui qui, en moins de six semaines, malgré la rigueur de l'hiver, a pris Valenciennes de force, mis ses ennemis en déroute, et réduit à son obéissance cambrai et Saint-Omer ; tout cela ne signifie que Louis le Grand. ( La Logique de Port-Royal I, VIII, distingue deux sortes de termes complexes : ceux qui le sont dans le sens et ceux qui le sont dans l'expression. Elle distingue en outre deux manières d'ajouter à un terme : la détermination et l'explication. ( Les grammairiens distinguent également deux sortes de propositions incidentes : les explicatives et les déterminatives. ) »
Les termes incomplexes ou simples sont ceux qui se réduisent à un seul mot, comme Dieu, arbre, homme ;
4° Universels, particuliers ou singuliers :
« Le terme singulier est celui qui ne signifie qu'une seule chose, comme Alexandre, Charlemagne, Louis le Grand. »
Il faut distinguer le terme général du terme collectif : le terme général est celui qui exprime une idée commune à un nombre indéterminé d'objets. Le terme collectif est celui qui rassemble en une somme ou collection un nombre déterminé d'individus : le soldat est un terme général, une armée est un terme collectif. Le terme général fait abstraction des individus, la terme collectif les prend tous ensemble.
« Les termes généraux ou universels sont ceux qui signifient plusieurs choses sous une même raison, par exemple, plusieurs animaux de différente nature sous la raison commune d'animal. »
Le terme particulier doit être distingué du terme singulier. En effet, celui-ci a rapport à un objet déterminé et individuel, mais le prend tout entier : Socrate, Paris sont des termes qui s'appliquent à tout Socrate, à tout Paris ; mais le terme particulier est celui qui, dans un tout général, ne s'applique qu'à un nombre indéterminé d'individus, comme lorsque je dis : quelques hommes : je conçois d'abord un terme général, et j'en prends qu'une partie.
En un mot, on définit le terme général ou universel, celui qui est pris dans toute son extension, et le terme particulier, dans une partie de son extension. Qu'est-ce que l'extension ?
315. Extension et compréhension.
On distingue deux choses dans les termes généraux ou universels : l'extension et la compréhension.
On appelle compréhension d'un terme l'ensemble des caractères ( notoe) par lesquels l'idée représentée est distincte d'une autre idée. C'est ce que les Allemand appellent le contenu ( das Inhall ) d'une idée. Par exemple, la compréhension du terme homme se compose de tous les caractères ou attributs qui désignent l'humanité et la distinguent des autres espèces animales. On appelle extension l'ensemble des sujets auquel s'appliquent les caractères précédents.
316. Loi de l'extension et de la compréhension.
Nous avons vu ( 159 ) que, pour former une idée générale, il faut supprimer les différences pour ne conserver que les ressemblances. Il suit de là que plus on généralise, plus on supprime de différences, c'est-à-dire de caractères distinctifs ; en d'autres termes, plus on augmente le ombres de sujets contenus sous une même idée, plus on diminue le nombre de leurs attributs, ce qu'on exprime ainsi : l'extension d'une idée générale est en raison inverse de sa compréhension « Un logicien allemand, Drobisch, qui a cherché à exprimer cette loi sous une forme mathématique, a trouvé que le rapport précédent n'est pas précisément celui de la raison inverse, mais que, ( tandis que l'extension croît ou décroît selon une progression géométrique, la compréhension croît ou décroît selon une progression arithmétique.) Uberweg, Logik, p. III. ». Par exemple, dans l'individu, l'extension est aussi étroite que possible ; au contraire, la compréhension est en quelque sorte infinie ; car on n'a jamais épuisé la description de l'individu ; pour s'élever de l'individu Socrate à l'espèce homme, il a donc fallu resserrer la compréhension pour augmenter la sphère de l'extension. Il en est de même pour passer de la sphère homme à la sphère animal, de la sphère animal, à la sphère être, etc. Réciproquement, si vous descendez l'échelle, vous ne restreignez l'extension qu'en augmentant la compréhension « Les termes d'extension et de compréhension, qui ne sont pas dans Aristote, viennent probablement de la scolastique. ».
317. Extension des termes.
L'extension ou la quantité d'un terme ou d'une idée ( ambitus, sph ra, extensio ) est donc l'ensemble des sujets auxquels ce terme ou cette idée convient ( 332 ). Par exemple, la sphère, l'étendue, la quantité du terme animal se compose de tous les animaux : la sphère ou l'étendue du terme blancheur se compose de tous les objets blancs.
Les différents termes, comparés entre eux, au point de vue de l'extension, donne lieu à différents rapports, qui sont :
1° La subordination : c'est le rapport qui existe entre deux termes contenus l'un dans l'autre, et dont l'un a une extension moindre que l'autre ; par exemple : homme et Européens. Le terme qui contient l'autre est appelé supérieur ; celui qui est contenu est appelé inférieur ou subordonné. Les termes inférieurs, comparés au tout qui les embrasse, sont encore appelés parties subjectives, par opposition aux divisions d'un tout réel, séparé en parties : celles-ci s'appellent parties intégrantes.
Le rapport de subordination peut être représenté par deux cercles concentriques, Le cercle A ( homme) et B ( Européens ).
2° La coordination est le rapport qui existe entre deux termes également subordonnés à un terme supérieur ; par exemple : A (courage) et B (prudence) sont l'un et l'autre contenus dans un même terme C (vertu). On peut représenter ce rapport par deux cercles de même rayon, contenus l'un et l'autre dans un troisième.
3° L'équipollence est l'identité de sphère qui existe entre deux termes différents, mais qui expriment une seule et même idée ; par exemple : A (le fondateur de la logique) et B (le précepteur d'Alexandre) sont les deux désignations d'une seule et même personne, qui est Aristote. Ici, les deux cercles se confondent en un seul.
Les notions équipollentes sont celles qui ont la même extension sans avoir la même compréhension : quand elles ont à la fois même extension et même compréhension, elles sont identiques.
4° L'opposition. L'opposition peut être double : ou la simple contrariété, ou la contradiction.
Deux termes sont contraires lorsque, réunis sous une même sphère, il sont les plus éloignés possibles l'un de l'autre ; par exemple : A (blanc) et B (noir), qui, quoique opposés, font partie d'un même terme C (couleur).
Deux termes sont contradictoires lorsque l'un des deux nie absolument le contenu ou la compréhension de l'autre ; par exemple A et non A ou B (blanc et non blanc). On représente A par un cercle et B par l'espace indéfini.
5° Le croisement. C'est le rapport qui existe entre deux termes qui coïncident en partie ; par exemple : A (nègres) et B (esclaves).
6° La disjonction. C'est l'opposition entre deux termes appartenant à la même sphère, c'est-à-dire subordonnés à un terme commun. Le symbole est le même que pour la coordination.
On voit que l'ensemble des termes universaux forme une échelle, ou plutôt une pyramide, dont la base se compose des individus, et dont le sommet ou la pointe est la notion la plus générale de toutes. Cette notion, selon la plupart des logiciens, serait celle d'être ou d'existence ; suivant d'autres, celle de quelque chose ( Aliquid, Etwas ) : car l'être lui-même se distingue de l'attribut, de l'accident, de la quantité, etc.
318. Les cinq universaux.
D'après les considérations précédentes, nous comprendrons facilement ce qu'étaient les cinq idées que l'on désigne dans l'école, depuis Porphyre, sous le nom d'universaux ; ce sont : le genre, l'espèce, la propriété, la différence et l'accident.
Le genre est un universel qui en contient d'autres comme subordonnés ; par exemple : animal, terme universel, contient homme, cheval, chien, qui sont eux-mêmes des termes universels.
L'espèce est un universel contenu dans un autre universel : chien, cheval, sont contenus dans l'universel animal.
Il faut distinguer l'espèce en logique de l'espèce en histoire naturelle. Dans l'histoire naturelle, l'espèce est un groupe concret et déterminé qui représente le dernier terme de la classification. En logique, l'espèce est une notion relative, qui exprime seulement le rapport d'un terme inférieur à un terme supérieur ; de même que le genre n'exprime autre chose que le rapport du terme supérieur au terme inférieur.
La même idée pourra donc être genre ou espèce, selon la manière dont on la considèrera : le triangle rectiligne, en tant qu'il est opposé au curviligne et au mixte, est une espèce de triangle ; et cependant il est genre à l'égard de ses inférieurs, c'est-à-dire l'isocèle, le scalène, etc.
Cependant, comme nous venons se le voir ( 333, F ), on peut concevoir un genre suprême, qui ne serait pas espèce, puisqu'il n'aurait rien au-dessus de lui : c'est ce qu'on appelle le genre généralissime ( genus generalissimum ) : ce serait le genre absolu. On peut concevoir également au plus bas degré de la pyramide des espèces qui ne seraient plus genres, puisque au-dessous d'elles il n'y aurait plus que l'individu : c'est ce qu'on appelle les plus basses espèces ( species infimoe ).
La propriété « Porphyre distingue quatre espèces de propriété : 1° celle qui convient à une seule espèce, mais non pas à toute l'espèce ( soli, non omni ) ; par exemple, être géomètre ne convient qu'à l'homme, mais non pas à tout homme ; 2° à toute l'espèce, mais non pas à elle seule ( omni, non soli ) ; par exemple, pour l'homme, avoir deux pied ; 3° à toute espèce, et à elle seule, mais non pas toujours ( omni, soli, sed non semper ), par exemple : blanchir, chez les veiillards ; 4° à toute l'espèce, à elle seule et toujours ( omni, soli et semper ), par exemple : la faculté de rire, pour l'homme. » est le troisième des cinq universaux.
« C'est, dit Bossuet, ce qui est entendu de la chose comme suite de son essence : par exemple, la faculté de parler, qui est une suite de la raison, est une propriété de l'homme ; avoir trois angles égaux à deux droits, est une propriété du triangle. ».
La différence est ce qui distingue un universel d'un autre. Elle est générique ou spécifique : générique, en tant qu'elle distingue les genres ; spécifique, en tant qu'elle sert à distinguer les espèces.
Enfin, on appelle accident ce qui peut être présent ou absent sans que le sujet périsse : par exemple, dans l'homme, le chaud et le froid, le blanc et le noir. L'accident s'oppose à l'essence.
319. Les catégories d'Aristote.
Il est d'usage, dans toutes les logiques, d'énumérer et de rappeler les dix catégories d'Aristote, quoique ces catégories appartiennent plus à la métaphysique qu'à la logique. C'est le tableau des idées les plus générales de l'esprit humain : ce sont la substance, la quantité, la qualité, la relation, l'action, la passion, le lieu, le temps, la situation, la possession « Pour l'explication de ces termes, voy. la Logique de P.-Royal, part. I, ch. Iii. ».
320. Lois des termes.
Bossuet a résumé toute la théorie des termes dans les propositions suivantes :
1° « Les termes signifient immédiatement les idées et imédiatement les choses elles-mêmes. »
2° Le terme naturellement est séparable de l'idée ; mais l'habitude fait qu'on ne le sépare presque jamais. »
3° « La liaison des termes avec les idées fait qu'on ne les considère que comme un seul tout dans le discours ; l'idée est considérée comme l'âme, et le terme comme le corps. »
4° « Les termes dans le discours sont supposés pour les choses mêmes, et ce qu'on dit des termes on le dit des choses. »
5° « Le terme négatif présuppose toujours quelque chose de positif dans l'idée ; car toute idée est positive. Le mot ingrat présuppose qu'on n'a point de reconnaissance ; le mot incurable présuppose un empêchement invincible à la santé. »
6° « Les termes précis ou abstrait s'excluent l'un l'autre : l'humanité n'est pas la science ; la santé n'est pas la géométrie. »
7° « Les termes concrets peuvent convenir et s'assurer l'un de l'autre : l'homme peut être savant ; celui qui est sain peut être géomètre. »
8° « Tout terme universel s'énonce univoquement « Un terme est univoque, quand il est pris dans le même sens ; équivoque, lorsqu'il est pris dans un sens différents. » de ses inférieurs. ».
9° « Les termes génériques et spécifiques ( genres et espèces ) s'énoncent substantivement : l'homme est animal ; Pierre est homme. ».
10° « Les termes qui expriment les différences, les propriétés et les accidents, s'énoncent adjectivement : l'homme est raisonnable ; il est capable de découvrir ; il est savant et vertueux. ».
L'œuvre de Paul Janet