révolution française
chapître LI à LX
joris Abadie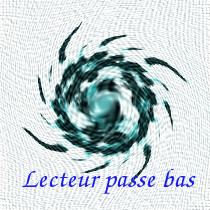
joris Abadie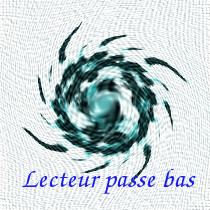
Le conquérant de l'Italie, le négociateur de Campo-Formio ne voulut pas laisser s'affaiblir la curiosité passionnée et enthousiaste qui s'attachait à sa personne. Il voulut surprendre et conquérir les volontés par une entreprise extraordinaire : il conçut la pensée de la conquête de l'Egypte.
Cette entreprise le transportait en Orient, pays des prodiges, sur un sol célèbre qu'avait foulé les grands conquérants du passé : Alexandre et César. Rien ne pouvait donner plus un plus grand coup aux imaginations.
De plus, conquérir l'Egypte c'était se rendre maître du commerce de l'Orient : c'était annuler les Indes, et frapper au coeur la puissance britannique.
Un grand philosophe allemand, Leibniz, avait proposé cette conquête à Louis XIV ; et les motifs profons qu'il développait dans un Mémoire à ce sujet, étaient les mêmes qui frappèrent et entraînèrent l'esprit enthousiaste et calculateur du jeune conquérant.
En 1777, au début de la guerre de l'Indépendance américaine, M. de Sartine, ministre de la marine, avait proposé une expédition française en Egypte. Tous les documents relatifs à ce projet étaient conservés au ministère de la marine, où Bonaparte a pu les consulter.
Une expédition fut préparée avec le plus grand soin, nul n'en savait la destination. On la crut destinée à l'invasion de l'Angleterre, dont il était question depuis des années.
Bonaparte quitta Toulon, le 19 mai 1798, enmenant avec lui une armée de 30.000 hommes, un choix de savants illustres, Monge, Berthollet, etc., et ses plus grands généraux, Kléber, Desaix, Lannes et Murat.
La flotte cingla d'abord sur Malte, forteresse imprenable, disait-on, mais qui, entre les mains d'un ordre déchu et corrompu, les chevaliers de Malte, ne résista pas à la première sommation de Bonaparte. Celui-ci s'en empara et y laissa une garnison.
De là, il se dirigea sur l'Egypte, en essayant d'éviter l'escadre anglaise, commandée par Nelson. Le bonheur, qui alors souriait à toutes les entreprises de Bonaparte, lui permit de débarquer toute son armée à l'insu des Anglais.
L'Egypte, sous la suzeraineté nominale de la Turquie, était occupée, gouvernée, opprimée par les Mamelucks, soldats mercenaires qui formaient une armée redoutable, sous le commandement de Mourad-Bey et d'Ibrun ahim-Bey.
La vieille cité d'Alexandrie, défendue par corps de troupes insuffisant, ouvrit ses portes au vainqueur.
De là, il marcha sur le nil remonta jusqu'au Caire, la véritable capitale de l'Egypte. C'est au-devant de cette ville, et en vue des Pyramides, qu'eut lieu la rencontre des deux armées. C'est là que Bonaparte prononça ces mots célèbres, que les Arabes répètent encore aujourd'hui aux voyageurs : " Du haut de ces Pyramides, quarante siècles vous contemplent. "
A la cavalerie de l'ennemi, dont le choc était étourdissant, Bonaparte opposa des bataillons carrés infranchissables ; et la tactique barbare dut céder à l'art savant et à la supériorité des armes.
Cette bataille qui décida du sort de l'Egypte, est ce que l'on appelle la bataille des Pyramides ( 23 juillet ).
Maître du Caire et du Nil, ayant écrasé et exterminé les Mamelucks, Bonaparte se hâta d'organiser sa conquête ; ménageant et même flattant les préjugés et les intérêts, il se donna comme le libérateur du pays, qu'il était venu, disait-il, arracher à l'oppression des Mamelucks. Il affecta même de prendre les moeurs et les usages des musulmans.
Un affreux désastre vint jeter un voile funèbre sur ces brillants événements. Notre flotte commandée par l'amiral Brueys, rencontrée enfin et attaquée par le fameux Nelson, avait été vaincue et complètement détruite dans la fatale bataille navale d'Aboukir ( 1er août 98 ). L'armée était captive en Egypte.
Cependant, la turquie, stimulée par l'Angleterre et la Russie, et avec laquelle on n'avait pris d'ailleurs aucune mesure de précaution, armait pour défendre contre la France la vaine suzeraineté qu'elle conservait sur l'Egypte.
Bonaparte, toujours prompt comme la foudre, marche contre l'armée turque en Syrie, la défait et la rend impuissante à la bataille du mont Thabor ( 16 avril 99 ). Il rêvait déjà de marcher sur Constantinople.
Mais la résistance de Saint-Jean-d'Acre le force à replier ses troupes, et il revient en Egypte assez tôt pour écraser à Aboukir ( 25 juillet 99) une autre armée qui y débarquait. Cette armée fut exterminée, et ce même lieu, célèbre par la ruine de notre flotte, l'est en même temps par l'une de nos grandes victoires.
La conquète de l'Egypte était assurée ; mais elle était inutile, et ne pouvait être conservée longtemps. Le seul résultat qu'elle eut pour la France, ce fut de lui assurer la première place dans l'étude scientifique de cette mystérieuse civilisation. Les Champollion, les Mariette, les Mespéro sont les vrais conquérants de l'Egypte, et leurs conquêtes sont indestructibles.
Rien de grand et de brillant ne restait plus à faire en Egypte pour le général Bonaparte. Pendant ce temps la guerre renaissait en Europe. Les ennemis de la France, exaltés par la nouvelle de la défaite navale d'Aboukir, heureux de savoir Bonaparte prisonnier avec son armée, avaient réuni une seconde et terrible coalition ; la fortune de tous côtés abandonnais nos armées : non seulement nos conquêtes nous échappaient, nos frontières mêmes étaient encore une fois menacées.
Ces malheurs, comme il arrive toujours, rejaillissaient sur le gouvernement. Le Directoire faisait eau de toutes parts : tous les partis le rendaient responsable de nos malheurs ; tous faisaient appel à un changement de gouvernement.
Le moment prévu et attendu par Bonaparte était arrivé. Il résolut de retourner en France ; préparant pour son départ dans le plus grand secret, laissant Kleber à la tête de son armée, il confia sa fortune comme César, à un navire, et traversant toute la Méditerranée, sans être rencontré par les Anglais, il débarqua à Fréjus, ( 9 octobre) accueilli par l'enthousiasme de tous, la crainte de quelques-uns, l'espérance du plus grand nombre.
La multitude voyait en lui un libérateur ; les sages prévoyaient un maître.
Jamais la France n'avait été si puissante qu'elle le fut vers 1797 et 1798. Non seulement les frontières s'étaient élargies, mais elle s'étendaient par son influence et son action bien au delà de ces frontières mêmes. La République avait transporté partout avec elle la Révolution française et s'était formé une ceinture de République vassales toutes organisées sur le plan de la République mère, et soumises à des Constitutions imitées de la Constitution de l'an III.
La France manifestait ainsi son esprit systématique et dominateur ; elle apportait la liberté aux peuples, mais il fallait qu'ils l'acceptassent toute faite, at qu'ils se gouvernassent, non d'après leurs propres principes, mais d'après ceux de leurs libérateurs.
Une première République avait été organisée en Italie par le général Bonaparte sous le nom de République Cisalpine. C'était l'ancienne Lombardie avec Milan pour Capitale, s'étendant jusqu'à l'Adige, et augmentée de Modène, de Bologne, de Ferrare, de la Romagne et d'une partie même du territoire vénicien. Il lui donna, d'après l'ordre du Directoire, la Constitution française.
Une seconde République également en Italie, dans laquelle Bonaparte fit une part un peu plus grande à l'élément aristocratique, fut la République Ligurienne, dont Gênes était la capitale.
Dans le Nord, le traité de Campo-Formio nous avait donné la Belgique ; mais la Hollande, quoique conquise par Pichegru, avait conservé en apparence son indépendance. Le stathoudérat seul avait été aboli. Le gouvernement de la Hollande avait pris le nom de République Batave. Plus tard une révolution analogue à celle du 18 Fructidor avait fait triompher l'élément démocratique, et la Constitution de l'an III régnait en Hollande ainsi qu'en France.
A ces trois Républiques vinrent bientôt s'en ajouter trois autres, toujours sur le même modèle.
A Rome, une émeute du parti démocratique avait amené un malheureux accident. Un Français, le général Duphot, avait été tué par les troupes, au moment où il essayait de calmer l'agitation populaire. Le Directoire ordonna au général Berthier de marcher sur Rome. Son approche seule suffit à provoquer une révolution, et la République Romaine fut proclamée (10 février 1798).
Le royaume de Naples, qui était encore entre les mains de la famille des Bourbons, fit la faute de vouloir attaquer les Français à Rome. Le général autrichien Mack qui commandait l'armée napolitaine, marcha contre Championnet, qui commandait les troupes françaises. Championnet vainqueur pris l'offensive à son tour ; et, ayant pris Napples sur les lazzaroni insurgés, il proclama la République Parthenopéenne (23 janvier 1799).
Enfin les Républiques elles-mêmes n'étaient pas à l'abri de la Révolution. La suisse, l'une des plus vieilles Républiques de l'Europe, mais où dominait encore le principe aristocratique et féodal, s'était également soulevée, et à la vieille Constitution fédérale avait substtué une Constitution nouvelle, calquée comme les autres sur la Constitution française. Cette nouvelle République prit le nom de République Helvétique (janvier-avril 1798).
Ainsi, la France était entourée de six Constitutions républicaines : Cisalpine, Ligurienne, Romaine, Parthénopéenne, Helvétique et Batave, toutes six occupées par ses troupes, animées de son esprit, gouvernées par ses lois. La suprématie de Louis XIV sur l'Europe n'avait pas été plus grande. La République avait égalé et surpassé la gloire de la Monarchie absolue.